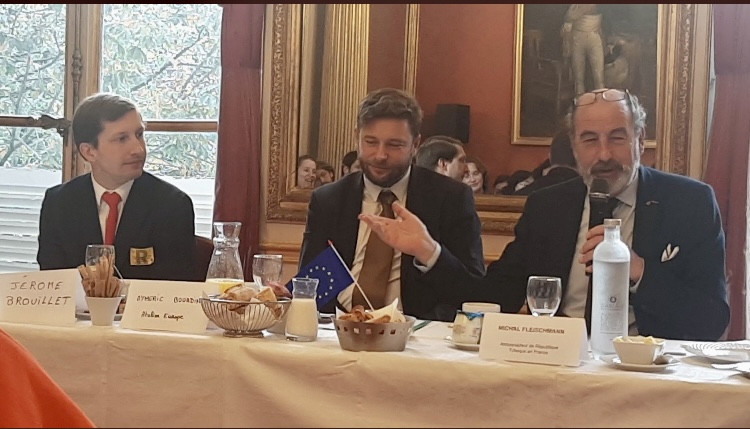Par Michaël Malherbe, Secrétaire Général, Atelier Europe
Alors que les prochaines élections européennes en juin 2024 suscitent déjà l’intérêt des observateurs, il est intéressant de réfléchir aux leçons à tirer des précédents scrutins. Analyser les campagnes de communication antérieures du Parlement européen pourrait permettre de mieux appréhender les dynamiques d’opinion et de communication au cœur du jeu institutionnel européen.
DÉCRYPTER LES SÉQUENCES DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION
DU PARLEMENT EUROPÉEN A L’OCCASION DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Quoique l’exercice de se porter sur le passé puisse paraître plus aisé que celui de se projeter dans le futur, la démarche n’en demeure pas moins délicate dans la mesure où il faut évaluer des actions de communication datées. En effet, il s’agit de reconstituer les contextes d’opinion de l’époque ainsi que de recomposer les récits faisant appel à la fois aux faits relatifs à ces campagnes et aux diverses stratégies et outils de communication. En décryptant les séquences des campagnes passées, nous pourrons tirer des enseignements pertinents pour 2024.
2009 : « A vous de choisir » : une communication plus tactique autour du « buzz game » que stratégique
En 2009, le Parlement européen, selon son communiqué à la presse, « lance sa première campagne de communication paneuropéenne, en vue de mobiliser 375 millions d’électeurs dans 27 pays ». Considérons donc cette « première » comme notre point de repère initial, d’autant plus intéressant que la finalité – la participation électorale – semble correspondre à ce qui pourrait apparaître comme l’objectif de communication le plus ambitieux et le plus légitime pour le Parlement européen parmi les trois registres d’objectifs informatifs, cognitifs et conatifs, ce dernier registre, le plus difficile pour toute action de communication, visant à faire changer les comportements.
Avec la signature « A vous de choisir », la campagne de communication se distingue d’une part par la faiblesse de son intention prescriptive : aller voter certes, mais aller voter ce que vous voulez, sous-entendu, le Parlement européen n’est pas là pour se mettre à la place des électeurs pour se forger une idée du choix à effectuer dans l’isoloir. D’autre part, la campagne paneuropéenne inédite se fait remarquer pour sa créativité très forte, qu’il s’agisse des moyens mis en œuvre pour attirer l’attention des médias et des citoyens avec des « coups » comme les “Eurostudios”, des sortes de « cahiers de doléance high tech » itinérants, mais surtout ce qui est passé en partie à la postérité, la logique du « buzz » autour de vidéos virales, comme la série « At the polling station » sans toutefois parvenir à combler le déficit d’animation partisane voire d’opposition idéologique de la campagne électorale.
En 2014, une communication plus politique : le « head game » du spin avec les Sptizenkandidaten
En 2014, l’état de l’opinion est très différent du précédent scrutin, l’Europe a vécu la crise économique, les tensions sur l’eurozone et l’opinion publique est beaucoup moins fertile à laisser pousser les racines de l’intégration européenne, sans faire germer des critiques et des déceptions. La campagne de communication du Parlement européen prend en compte ce contexte avec la signature « Cette fois-ci, c’est différent ».
Toute la difficulté consistera à construire un narratif et des preuves pour faire la démonstration que c’est définitivement bien différent. A plus d’un titre, cette campagne le sera. D’abord, dans ses finalités, l’injonction de la campagne en 2014 ne semble plus d’inciter les citoyens à participer au scrutin, comme lors de la précédente, et normalement de toutes les campagnes institutionnelles dans ce cadre, mais il s’agira bien plutôt d’assurer la promotion de l’institution du Parlement européen dans le jeu institutionnel bruxellois. Ensuite, dans ses moyens, la communication du Parlement européen repose sur un levier politique avec la vidéo « human-manifesto » dont le bloc marque final « Agir. Réagir. Accomplir. » semble tenter de poser un positionnement du Parlement européen, en tant qu’institution, bien loin des seuls enjeux du scrutin européen. Enfin, la volonté de montrer à quel point le scrutin de 2014 est différent conduira le Parlement européen à investir dans une démarche visant à sensibiliser les citoyens européens aux têtes de listes des partis politiques européens, les fameux Spitzenkandidaten, déduits du traité de Lisbonne, un pari institutionnellement risqué mais politiquement gagnant pour le Parlement européen, qui s’impose davantage dans le jeu institutionnel mais qui ne sera pas payant en revanche contre l’abstention.
La tentative d’un embryon de campagne électorale paneuropéenne et européo-centrée n’a pas réussi à mobiliser en masse ni le corps électoral, ni les grands médias, mais cette visibilité et cette dynamique n’a pas été totalement perdue pour le Parlement européen.
En 2019, une communication plus engagée tant avec le « air game » que le « ground game »
Entre 2014 et 2019, avec la Commission « politique » Juncker, l’action de l’Union européenne, en réponse aux nouvelles crises, évolue, s’incarne, se concentre en termes de storytelling sur quelques fils narratifs plus compréhensible comme le Brexit, la crise des migrants ou encore le plan d’investissement. Les citoyens européens, confrontés à une réalité plus dure, se projettent différemment dans la construction européenne, leurs attentes tant en matière d’intégration que de désintégration prennent des formes plus mainstream, parfois aussi plus menaçante, songeons notamment à la poussée de forces europhobes. La signature de la campagne du Parlement européen « Choisis ton futur » pose beaucoup plus clairement la problématique du scrutin européen, tandis que les arguments se font plus prescriptifs pour dessiner un choix de société, un choix civilisationnel, un choix proeuropéen assumé.
Engagée en faveur du projet d’intégration européenne pour la première fois, la campagne de communication du Parlement européen semble également changer de posture et d’attitude vis-à-vis des électeurs européens. Plutôt que d’investir exclusivement sur son auto-promotion ou celle des Spitzen, le Parlement européen privilégie une communication au service et en position de ressource pour les citoyens. Cet investissement, qui se traduit par des démarches telles que la plateforme civique « This Time, I’m Voting » pour fédérer une mobilisation de helpers désireux de partager à leurs proches leurs raisons de participer ainsi que le portail « What Europe Has Done For Me » qui rassemble des contenus pédagogiques, synthétiques, utiles pour savoir « ce que l’UE fait pour vous » et les réalisations du Parlement européen. Les résultats font dorénavant partie de l’histoire, puisque pour la première fois depuis le premier scrutin européen en 1979 la participation électorale s’améliore sensiblement.
Une campagne de communication résolument proeuropéenne et délibérément orientée vers le soutien aux citoyens – afin de répondre à leurs attentes, pour beaucoup, d’informations sur l’UE ainsi que pour certains, l’envie de se mobiliser – aura donc été vraiment payante.
Que faut-il retenir ? Chaque campagne à l’occasion des élections européennes est une opportunité pour le Parlement européen de se positionner sur un registre de communication, qui entre en résonnance avec le moment. En 2009, le partage d’un espace politique européen commun ; en 2014, le partage d’une scène politique européenne commune et en 2019, le partage d’une controverse politique commune Pro-Européens contre Europhobes. Reste à savoir ce qui nous réunira ensemble en 2024.