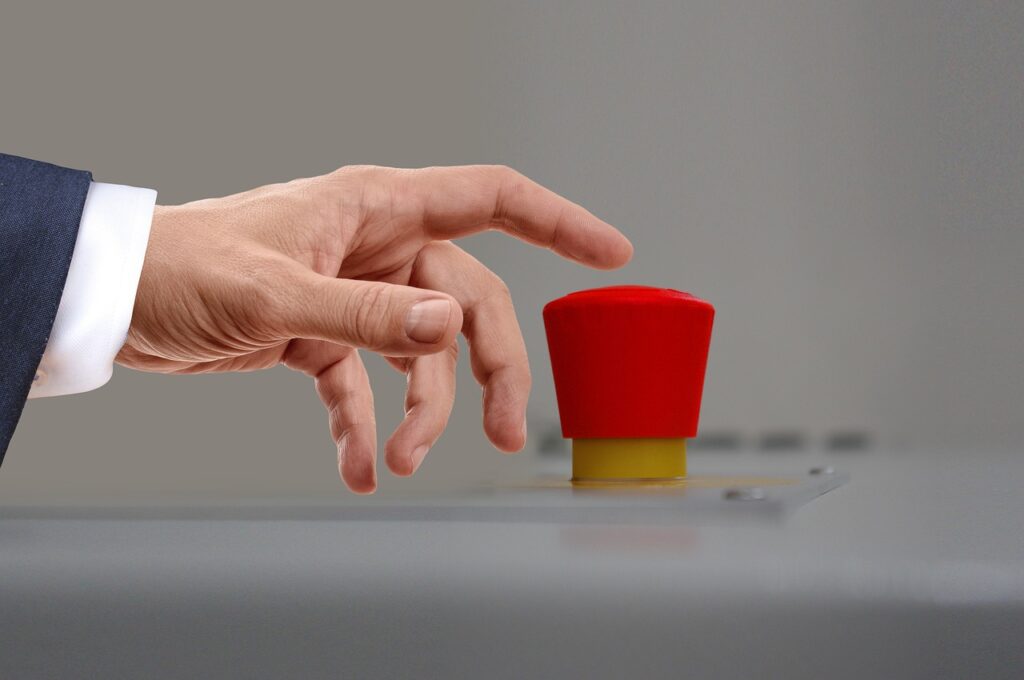par Michaël Malherbe, Secrétaire Général
Nombreux sont ceux qui s’attendaient à une entrée en campagne sur la souveraineté technologique de l’Europe dans les données, l’intelligence artificielle, la 5G ou les services numériques. L’on s’attendait sans doute à tout ce qui nous permettrait de réussir le XXIe siècle de l’Europe. A tout sauf à l’agriculture.
Adieu veau, vache, cochon, couvée
Et patatras, comme dans la Fable de Jean de La Fontaine, « Quel esprit ne bat la campagne ? Qui ne fait châteaux en Espagne ? » Face au lait renversé, « Je suis gros Jean comme devant ». « Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée » ! C’est sans doute ce que nous pouvons constater avec ce coup d’envoi de la campagne des élections européennes de juin prochain, qui aura finalement bel et bien commencé : à côté des sujets technologiques, géopolitiques, sanitaires, un thème ancien a émergé dans la foulée d’une contestation.
Comment cette campagne qui n’a cessé de se dérober à ceux qui tentaient de s’en saisir, depuis plusieurs semaines déjà, est-elle parvenue à rompre le désintérêt des différents acteurs européens ? Mille et un scénarios pouvaient dorénavant s’échafauder à mesure que les nouvelles responsabilités de l’Europe accumulées pouvaient offrir un angle à la campagne électorale. Au cours de la mandature, l’UE s’est notamment vue confiée de nouvelles responsabilités sur des enjeux majeurs comme la lutte contre la pandémie de Covid ou le soutien contre l’agression russe en Ukraine, autant d’eau potentielle au moulin du débat électoral. Les états-majors des partis politiques européens ne cessaient de bâtir des plans de bataille, mais rien n’y faisait, la campagne ne prenait pas.
C’est par le plus vieux métier de l’Europe que la campagne électorale a déchiré le voile
De manière fracassante, tant le drame est malheureusement complet, la détresse des agriculteurs est enfin parvenue à capter l’attention des citoyens. On retiendra donc, à l’ère de la polémique virtuelle, quotidienne, stérile, que ce sera l’un des sujets les plus européens qui aura ouvert le bal de la campagne européenne. L’agriculture s’est manifestée aux premières loges de nos consciences médiatiques par la crise d’un secteur en plein chantier.
Pourtant, pour tous ceux qui suivent attentivement l’actualité des affaires européennes, il faut dire que le feu couvait depuis quelques temps. Les premiers pas de la nouvelle Commission von der Leyen se sont déroulés conformément au programme, autour d’une ambition majeure, le Pacte vert pour l’Europe, porté par Frans Timmermans, un Vice-Président entreprenant. Mais, celui-ci a quitté son poste avant la fin de son mandat, pour rejoindre la politique nationale néerlandaise, laissant le Green Deal orphelin de son principal avocat, alors que certains des textes les plus difficiles étaient encore en discussion.
Creusons le cœur du contentieux, qui s’est porté sur le projet de restauration de la nature, un texte prévoyant de fixer pour la première fois des objectifs contraignants pour restaurer les écosystèmes, les habitats et les espèces afin de mettre en place des mesures de restauration efficaces afin de couvrir au moins 20 % des superficies terrestre et maritime de l’UE d’ici à 2030, considérant en particulier que la productivité agricole dépend de la santé des écosystèmes et notamment des pollinisateurs.
Lors des discussions au Parlement européen pour l’adoption du texte sur la restauration de la nature, nous avons assisté sans doute au mélodrame le plus intense de la mandature, avec une sorte de victoire à la Pyrrhus qui a laissé beaucoup de traces. Comptons les forces en présence et regardons le résultat après la bataille.
Du côté des partisans du texte sur la restauration de la nature à compter dans les rangs des eurodéputés qui ont largement voté pour la confirmation d’Ursula von der Leyen en début de mandat, les grands principes du Green Deal sont sauvés, la victoire n’est que de façade, mais disons qu’on a sauvé les meubles, la vision d’un modèle, d’une société idéale zéro-carbone.
Du côté des opposants, qu’il a fallu chercher au cœur même de la famille politique de la présidente de la Commission européenne, le PPE, rassemblant la droite européenne, ce texte fut la goutte d’eau qui fit déborder le vase, le calice à boire jusqu’à la lie qu’ils ne pouvaient justement plus assumer auprès de leur famille politique, au cœur des zones rurales et des territoires.
The Perfect Storm
C’est ce que l’on appelle #ThePerfectStorm, qui rassemble de nombreuses injonctions contradictoires, révèle des lignes de fracture profondes, suffisantes pour potentiellement redéfinir les contours entre des majorités et des oppositions non pas de circonstance, mais durables, irréversibles, comme ce fut le cas pour les fameuses deux gauches irréconciliables théorisées par Manuel Valls.
D’un côté, les partisans d’une vision généreuse de la société future, bas-carbone, sympathique et écologiste, respectueuse de la biodiversité animale et végétale. Un modèle de société promu dans une démonstration qui nous explique que nous n’avons pas le choix pour lutter efficacement contre les dérèglements climatiques. C’est à prendre ou sinon c’est la fin du monde.
De l’autre, les soutiens du monde réel, concret, matériel, des habitants des zones rurales, des acteurs qui ne s’occupent pas seulement d’entretenir les paysages pour la beauté du geste, mais qui vivent de leur activité dans les pays, le monde des paysans.
Comment une telle divergence existentielle, autour de la politique européenne la plus emblématique, la plus historique et dorénavant la plus contestée et critiquée aura-t-elle pu passer aussi longtemps sous silence ?
Les agriculteurs, en France, mais aussi dans la plupart des États-membres, ont une relation ancienne avec l’Union européenne, pourvoyeuse de fonds visant à transformer le secteur, à une certaine époque, vers des logiques de productivité et d’auto-suffisance, davantage aujourd’hui vers une forme de souveraineté alimentaire, dont l’ouvrage devra être remis sur le métier.
Le vade-mecum de campagne
En définitive, l’opération de préemption de ce début de campagne par les agriculteurs est une très bonne nouvelle, d’abord parce que leur drame est un sujet qui mérite vraiment qu’on s’y intéresse pour y apporter des réponses à long-terme. Ensuite, parce que cela nous rappelle à tous qu’en Europe, rien ne se fait sans cette capacité à construire des coalitions, qui fait que ce sont des agriculteurs aux quatre coins de l’hexagone français et de l’Europe tout entière qui se manifestent et expriment leur désespoir. Enfin, parce que ce sujet, comme nous venons de le voir, est sans doute le plus susceptible de permettre aux Européens de faire des choix de société engageants, structurants pour l’avenir, cohérents vis-à-vis de nos engagements, d’une grande lisibilité pour le grand public et d’une certaine logique aussi dans les relations futures avec nos différents partenaires.
Au détriment de leur propre existence, les agriculteurs nous montrent aussi le coût politique très élevé à payer pour parvenir à capter l’attention concomitante, à la fois des pouvoirs publics nationaux et européens, mais également des médias d’information, sans oublier évidemment les citoyens-électeurs.
Ce sera justement le rôle de la campagne des élections européennes de 2024, qui ne semblait pas encore s’être donné une éventuelle mission, de débattre de nos choix existentiels pour l’une des activités économiques les plus illustres et les plus nobles, qui avait été au cœur du projet de la construction européenne, compte-tenu de sa capacité à fédérer autour d’une vision commune. Et puis, il faudra formuler des propositions cohérentes, réalistes, respectueuses pour cette politique publique, la PAC, qui en a vu bien d’autres. Et il s’agira enfin de trancher entre les options des différentes familles politiques.