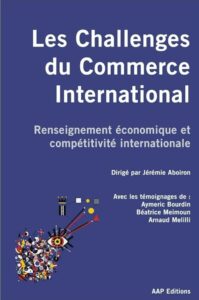Par Michaël Malherbe, Secrétaire Général
L’HEURE DES CHOIX POUR UNE 3E VOIE EUROPÉENNE : DE LA PROLIFÉRATION NORMATIVE A LA COHÉRENCE STRATÉGIQUE
À l’heure où l’intelligence artificielle bouleverse nos sociétés et où les tensions géopolitiques s’exacerbent, l’Union européenne achève une mandature marquée par un foisonnement réglementaire sans précédent dans le domaine numérique, au point que l’Europe s’est imposée comme le premier régulateur mondial des technologies numériques. Pourtant, cette prolifération normative soulève aujourd’hui des interrogations cruciales : l’accumulation de textes garantit-elle leur efficacité ? Comment concilier protection des droits et innovation dans un contexte de compétition internationale accrue ? L’Europe peut-elle maintenir son leadership normatif sans compromettre sa souveraineté technologique ? L’Europe numérique est à la croisée des chemins. Entre le modèle chinois centré sur la sécurité nationale et l’approche américaine privilégiant la liberté d’entreprendre, l’Union européenne a fait le choix d’une régulation protectrice des droits des citoyens. Mais cette « troisième voie européenne » doit désormais relever le défi de la cohérence et de l’efficacité, au risque de voir son influence s’éroder face aux géants technologiques américains et chinois.
- Un arsenal réglementaire sans précédent : bilan d’une mandature ambitieuse
La mandature 2019-2024 a été marquée par un foisonnement réglementaire sans précédent dans le domaine numérique, initié par le commissaire Thierry Breton dans le cadre de sa feuille de route « Digital Decade 2020-2030 » ou « décennie numérique de l’Europe ».
Pour le think tank Renaissance Numérique, dans Bilan mandature : Politique numérique de l’UE : l’heure de la cohérence a sonné « le tumulte de la transformation numérique de nos sociétés […] a été marqué par une succession de réglementations dans la foulée de l’entrée en application du RGPD en 2018 ».
Songeons aux principales législations adoptées comprenant :
- Régulation des plateformes : Digital Markets Act (DMA) – 2022 ; Digital Services Act (DSA) – 2022
- Stratégie sur les données : Data Governance Act – 2022 ; Data Act – 2023 ; European Health Data Space (en cours)
- Intelligence artificielle : AI Act – 2024 ; Directive sur la responsabilité de l’IA
- Cybersécurité : Directive NIS 2 ; Cyber Resilience Act ; Règlement DORA
Comme l’analyse la Fondation Robert Schuman, dans « Législation numérique : convergence ou divergence des modèles ? Un regard comparatif Union européenne, Chine, États-Unis » par Aifang Ma, Chercheuse post-doctorale Boya, Université de Pékin et Chercheuse associée, Sciences Po Paris : « l’Union européenne s’impose comme l’exemple type de l’arsenal juridique en matière numérique. Elle a institutionnalisé plusieurs méthodes : le droit à l’oubli numérique, la définition qualitative et quantitative de la position dominante des plateformes, et la gestion de l’IA basée sur les risques ».
Cependant, cette prolifération législative soulève plusieurs inquiétudes :
- Un manque de cohérence d’ensemble pointé par Renaissance Numérique avec « l’empilement de législations parallèles touchant au numérique laisse désormais entrevoir un paysage juridique aussi complexe que fragmenté » et « l’absence d’une vision d’ensemble et d’une gouvernance transverse ».
- Des risques de conflits entre régulateurs pour ce think tank qui alerte sur « la superposition des obligations réglementaires susceptibles d’entraîner de nombreux conflits de compétences entre régulateurs anciens et nouveaux […] sans arbitre ni procédures d’arbitrage ».
- Un impact potentiel sur la compétitivité selon la Fondation Robert Schuman qui souligne que « légiférer de manière préemptive n’est pas toujours propice à la croissance des plateformes numériques. Les effets dissuasifs ont tendance à décourager des entreprises de se lancer dans l’innovation technologique ».
Le bilan apparaît donc contrasté. Certes, en matière de régulation numérique, l’Union européenne peut se targuer d’un titre de leader normatif mondial et surtout d’une protection renforcée des droits des citoyens, voire d’un cadre juridique pionnier repris par d’autres pays. Mais, ces législations qui se chevauchent davantage qu’elles ne se complètent, créent de la complexité réglementaire, des risques pour l’innovation et la compétitivité des entreprises, sans compter les défis liés à la mise en œuvre à l’échelle des États-membres.
Bref, comme le résume Renaissance Numérique : « à force de combler des poches dites de « non-droit », le droit européen du numérique comporte des zones de « sur-droits » ou de « plusieurs droits ». Non par oubli de désigner des régulateurs, mais par leur superposition, sans mécanisme de cohérence transverse ».
Cette situation appelle à une rationalisation et une meilleure articulation des différents textes pour la prochaine mandature, afin de préserver l’équilibre entre protection des droits et innovation.
- Entre trois modèles : l’exception européenne face aux défis géopolitiques
Comme l’analyse la Fondation Robert Schuman, trois modèles distincts de régulation numérique émergent au niveau mondial, reflétant des priorités et des valeurs différentes :
- Le modèle européen : priorité aux droits des citoyens
« La protection des droits des citoyens est au cœur des politiques et législations en Europe. […] La manière dont l’Union européenne organise l’accès à internet peut être définie ainsi : restreindre la liberté des entreprises pour augmenter celle des individus ». La régulation numérique à l’européenne repose sur une approche préventive et prudente, des sanctions financières dissuasives, une protection forte des données personnelles et une régulation asymétrique selon la taille des acteurs.
- Le modèle américain : priorité à la liberté d’entreprise
« Politiques et législations des activités numériques américaines se caractérisent par la centralité de la liberté d’entreprendre ». La Section 230 du Communications Decency Act illustre cette approche en protégeant les plateformes de toute responsabilité éditoriale.
Une autre réflexion vient également de l’Institut Montaigne avec Charleyne Biondi, Chercheuse associée dans « [Trump II] – Les risques pour la souveraineté technologique européenne » qui souligne que « face à une industrie américaine déréglementée, et sans le soutien politique des États-Unis pour établir des normes communes de gouvernance au niveau international, l’UE risque de se trouver ostracisée par ses propres lourdeurs réglementaires ».
- Le modèle chinois : priorité à la sécurité nationale
Comme l’explique la Fondation Robert Schuman : « Le grand paradoxe en Chine est la coexistence entre une économie numérique dynamique et un cadre strict. […] Alors que le versant économique se fait de manière décentralisée […], le versant politique est marqué par sa centralisation ».
« Au cas où la transgression de règles par les sociétés numériques nuirait à la sécurité nationale ou à la stabilité sociale, l’État-parti réagit promptement […]. Les intérêts économiques sont, au moins temporairement, relégués à une position secondaire ».
Ces différences d’approche reflètent des visions distinctes du numérique et de son rôle dans la société. Comme le résume la Fondation Robert Schuman : « Ces trois modes peuvent parfois se chevaucher mais il existe une hiérarchie des normes difficile à inverser. Cela se traduit en particulier dans des circonstances où des objectifs distincts se gênent ».
III. Vers une stratégie numérique européenne repensée : Recommandations pour la prochaine mandature
La position de l’UE dans la rivalité technologique sino-américaine soulève des défis majeurs :
- Une souveraineté technologique menacée
Comme l’analyse l’Institut Montaigne, l’UE risque d’être « prise en étau » entre les États-Unis et la Chine sur plusieurs plans. Non seulement la dépendance aux terres rares : « l’UE, qui dépend à 98% de la Chine pour ses composants critiques, pourrait se retrouver indirectement prise en otage » dans une guerre commerciale sino-américaine. Mais aussi, la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement : « l’intensification des tensions commerciales pourrait pousser la Chine à réagir […] par des restrictions d’exportation sur des matériaux essentiels » ce qui aura un impact sur les chaînes d’approvisionnement des industries européennes.
- Le dilemme de la régulation de l’IA
L’approche européenne de régulation de l’IA illustre les tensions entre leadership normatif et impacts sur la compétitivité et l’innovation comme le souligne l’Institut Montaigne « face à une industrie américaine déréglementée […] les lourdeurs de l’AI Act pourraient condamner l’Europe à un retard irrattrapable en matière d’innovation ».
Le défi d’une gouvernance de l’IA et de normes communes au niveau international semble aussi souhaitable au regard du nouveau paradigme de l’IA aux effets quasi anthropologiques sur nos sociétés qu’utopique compte-tenu de la divergence entre les modèles de régulation numérique américain, chinois et européen.
Avec l’arrivée de Trump à la Maison Blanche, c’est un programme de dérégulation de l’IA au profit d’une innovation à tout crin qui s’annonce. Les entreprises technologiques auront moins de contraintes mais les utilisateurs prendront plus de risques, quant aux « obligations de transparence sur les méthodes d’entraînement ou la gestion des biais, au risque de multiplier des usages irresponsables de ces technologies qui pourraient favoriser la discrimination, les préjugés ou la désinformation », selon l’Institut Montaigne.
Du côté européen, le rapport Draghi pointe de potentiels effets secondaires de l’AI Act européen pour la compétitivité des industries européennes. Charleyne Biondi, de l’Institut Montaigne point que « l’AI Act apparaissait déjà comme une approche assez risquée pour la compétitivité du secteur européen : jugé trop rigide pour permettre les innovations qu’il prétend encourager, et peu adapté aux évolutions rapides de ces technologies, il pourrait définitivement condamner les ambitions technologiques européennes dans un contexte global de déréglementation ».
- L’effet Bruxelles en question
Si l’influence normative européenne reste forte, comme le note la Fondation Robert Schuman, cf. « les pratiques européennes sont imitées en dehors de l’Union », elle est menacée par la fragmentation réglementaire interne avec « l’empilement de législations parallèles […] aussi complexes que fragmentées » mais aussi la concurrence normative internationale , puisque l’Institut Montaigne note que « d’autres juridictions, comme le Royaume-Uni, renoncent finalement à réguler trop sévèrement leur industrie pour éviter un désavantage comparatif avec les États-Unis ».
- Des opportunités à saisir
Nonobstant les opportunités d’affichage tel que le « leadership éthique » pointé par l’Institut Montaigne qui suggère que « l’UE a une rare opportunité de s’affirmer comme leader en matière de gouvernance éthique de l’IA » ou « Face à Trump, l’Europe a « l’attrait des résistants ». Elle peut ainsi rêver de séduire entreprises et investisseurs à la recherche d’un environnement moins incertain ».
Face aux défis identifiés, les trois think tanks formulent des recommandations complémentaires pour la prochaine mandature européenne. Il s’agit d’abord de rationaliser le cadre réglementaire existant. Renaissance Numérique insiste sur l’urgence d’une mise en cohérence : « Il est impératif que la nouvelle mandature européenne œuvre à la mise en place de textes de procédure et d’interprétation afin de garantir une articulation efficace entre les grands textes législatifs européens ».
Il convient surtout de développer une vision stratégique cohérente. Renaissance Numérique insiste sur la nécessité « de rationalisation réglementaire (qui) vise en réalité à assurer une efficacité transverse du droit européen du numérique ». (…) : « Lorsque plusieurs objectifs louables sont juxtaposés sans se soucier de leur articulation, toutes les protections et garanties espérées peuvent produire des effets inverses et, a minima, aucun effet espéré ».
La Fondation Robert Schuman complète : « Il est important d’endiguer et de prévenir les dérives néfastes de l’économie numérique, mais il l’est encore plus de créer un environnement favorable pour la croissance des entreprises. Législations et politiques du numérique en Europe doivent être aussi facilitatrices que restrictives ».
Alors que la nouvelle Commission von der Leyen commence à déployer son agenda, ces recommandations pour les décideurs européens convergent vers la nécessité d’une approche plus équilibrée et cohérente, conjuguant protection des droits, efficacité réglementaire et dynamisme économique.
L’Union européenne se trouve à un moment charnière de son développement numérique. Face à la montée en puissance du techno-populisme incarné par Elon Musk et à la perspective d’une présidence quasi-impériale de Donald Trump, l’Europe doit repenser sa stratégie numérique pour préserver à la fois sa souveraineté technologique et ses valeurs fondamentales.
Le modèle européen de régulation, caractérisé par une forte protection des droits individuels, se trouve confronté à un double défi. D’une part, la probable dérégulation américaine sous Trump risque d’accentuer le fossé de compétitivité technologique entre les deux continents. D’autre part, l’approche libertarienne promue par Musk, combinant innovation technologique débridée et discours anti-establishment, met à l’épreuve la vision européenne d’un numérique régulé et responsable.
Pour maintenir sa pertinence, l’Europe doit rationaliser son arsenal réglementaire pour le rendre plus cohérent et efficace, développer une véritable stratégie d’innovation compatible avec ses valeurs, renforcer sa souveraineté technologique tout en préservant sa capacité d’influence normative et trouver un équilibre entre protection des droits et compétitivité économique.
Offrant une alternative crédible aux modèles chinois et américain, la « troisième voie » européenne ne pourra émerger qu’en démontrant qu’une régulation intelligente peut coexister avec une innovation technologique au service du progrès.